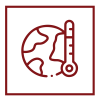Benjamin Dessus, Président de Global Chance
Liaison Énergie Francophonie, n°78, « Spécial XXème anniversaire de LEF », 1er trimestre 2008, Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie
Télécharger l’article dans sa mise en page d’origine (format pdf)
Depuis Kyoto, beaucoup de choses ont changé : les craintes d’un emballement incontrôlable du climat à court terme deviennent plus que sérieuses, le prix du pétrole a augmenté d’un bon facteur 4, les grands pays émergents connaissent des croissances à deux chiffres, les Etats Unis boudent le protocole de Kyoto, la mondialisation financière bat son plein…
Comment, dans ce contexte nouveau, faire face au défi climatique et énergétique qui nous guette ? Nous le disons, avec d’autres, depuis plus de 20 ans : la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables sont les priorités à portée de la main sans lesquelles nous courons droit à la catastrophe.
N’oublions pas pour autant, au delà de l’indispensable mobilisation sur les réductions d’émissions de CO2, de nous préoccuper des autres gaz à effet de serre, et en particulier de la réduction du méthane, trop souvent négligée : elle peut nous aider fortement à passer le cap des quelques décennies qui viennent, où se cumulent les inerties démographiques et les nécessités du développement.
Et puis, cessons de croire que la croissance, la marchandisation des biens communs, et les utopies technologiques, sont les remèdes miracle à tous nos maux. Plus que de discours et de bulles boursières sur les biens d’environnement, c’est de politiques sérieuses, solidaires, pérennes et volontaires dans chacun de nos pays qu’il nous faut exiger de nos gouvernements.
* * *
Depuis les débuts de Liaison Énergie-Francophonie je me suis souvent associé à ses publications, comme bien d’autres membres de Global Chance, pour y apporter notre analyse des problèmes d’énergie, de développement et d’environnement. Le pari qui nous a en effet toujours animés et qui est à l’origine de la création de notre association est que la prise de conscience des questions globales d’environnement pouvait et devait être transformée en une chance de nouvelles solidarités et de nouvelles actions pour le développement durable.
C’est pourquoi, plutôt que de se contenter de jouer les Cassandre, Global Chance a toujours tenté de proposer des pistes de solution crédibles aux nombreux problèmes posés, sans jamais perdre de vue les exigences de solidarité et de démocratie.
D’où, dans notre domaine spécifique d’expertise, l’énergie, notre insistance sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, que nous considérons depuis longtemps comme les deux piliers principaux d’une politique énergétique à la fois équitable et solidaire pour le développement et compatible avec les défis environnementaux auxquels l’humanité se trouve confrontée.
Aujourd’hui l’avenir n’est plus ce qu’il était !
Au tournant des années 90, à la conférence de Rio, les craintes d’un réchauffement climatique trop rapide sont venues, dans un contexte de contrechoc pétrolier, relayer les préoccupations d’environnement transfrontières, comme les pluies acides, qui prévalaient dans les années 80. C’était l’émergence d’une prise de conscience publique des problèmes globaux d’environnement mais aussi celle de la nécessité d’y trouver des réponses globales mais diversifiées acceptables pour l’ensemble de la communauté humaine.
Le choix finalement retenu a été celui d’engagements de résultats (des objectifs quantitatifs) plutôt que d’engagements de moyens, comme des politiques de taxation ou de réglementation. Sous la pression des Etats Unis, l’Europe acceptait, un peu à reculons, l’idée d’une marchandisation internationale du carbone destinée à réduire les coûts globaux des engagements, grâce au commerce de quotas de CO2 entre pays. Mais à l’époque, les outils de flexibilité de Kyoto qui traduisaient cette volonté d’échanges, devaient rester, tout au moins dans l’esprit des négociateurs européens, un complément marginal éventuel à des politiques et mesures domestiques ou internationales supposées régler l’essentiel du problème.
Reste que le choix d’objectifs quantifiés de réduction par pays d’un ensemble indifférencié de gaz à effet de serre (GES) et la volonté d’en développer le commerce, sont à l’origine de la définition de concepts tels que la tonne d’équivalent CO2 et son corollaire « le potentiel de réchauffement global » d’un gaz par rapport au gaz carbonique. Le choix d’une référence au seul CO2 a entraîné de facto la focalisation de l’attention des acteurs sur le rôle de l’énergie dans le changement climatique, au détriment de toute autre considération.
Globalement cependant, malgré les divergences d’opinion qui demeuraient sur les moyens d’action, le protocole de Kyoto représentait une avancée importante : c’était la première fois qu’émergeait l’idée d’objectifs contraignants, même s’ils restaient beaucoup trop modestes pour certains. Mais à l’époque, le risque climatique semblait encore bien éloigné aux décideurs, vers 2100 ou au-delà. Dans ces conditions c’est l’inflexion des tendances, plus que son ampleur, qui paraissait comme l’essentiel.
Dix ans plus tard, la situation a fondamentalement changé sur de nombreux plans :
• Les Etats Unis, le plus important émetteur de GES, ont, dès l’accession de Georges Bush au pouvoir, refusé de ratifier le protocole de Kyoto, fragilisant ainsi gravement la portée de l’accord obtenu à Kyoto.
• L’envolée des prix pétroliers, dont personne n’est capable de dire encore aujourd’hui si elle est due à une contrainte réelle sur les ressources à très court terme ou à des phénomènes de pure spéculation, probablement les deux, réactualise la crainte, si ce n’est d’un épuisement des énergies fossiles à horizon rapproché, du moins d’un pic de production [1], au-delà duquel la production déclinerait inéluctablement.
• Le très rapide développement des grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil) modifie profondément les rapports de force internationaux en même temps qu’il provoque une hausse sensible des émissions de GES mondiales.
• Le discours de la communauté scientifique sur l’imminence du danger climatique a beaucoup évolué. D’une part, les preuves d’un réchauffement plus rapide que prévu s’accumulent, les calculs scientifiques se précisent.
• L’évolution des émissions mondiales dépasse les projections les plus pessimistes des scénarios du GIEC (depuis l’année 2000 par exemple les émissions mondiales de GES ont augmenté de 3% par an alors qu’on attendait au pire une croissance de 1,5% dans les scénarios « business as usual »). L’échéance des préoccupations s’est donc considérablement rapproché, d’au delà de 2100 à bien avant 2050, peut être 2030 ou 2040. Quand on lit en effet l’ensemble du dernier rapport du GIEC et les publications postérieures à ce rapport, on se rend compte, même si leurs auteurs hésitent parfois à le proclamer haut et fort, que la poursuite des tendances actuelles nous mène à la quasi certitude d’aboutir à une situation totalement incontrôlable dès 2030 ou 2040, du fait d’une augmentation trop forte de la température moyenne de la terre. Les climatologues craignent en effet des irréversibilités aussi importantes que la fonte du permafrost avec le dégagement de grandes quantités de méthane, ou le basculement des sources d’absorption que sont l’océan et la biomasse en sources d’émission de CO2 susceptibles de déclencher une dérive sans retour du climat terrestre.
• Le réchauffement climatique est devenu une préoccupation majeure des opinions publiques et la lutte contre ce réchauffement et ses conséquences un sujet politique à part entière.
• L’explosion de la mondialisation financière et la chute corrélative de l’influence des Etats démoratiques conduit à une généralisation de la marchandisation des biens communs y compris des biens d’environnement, même en Europe : la Commission Européenne, séduite par les thèses néolibérales, a mis en place un système de quotas au niveau des entreprises industrielles et une bourse d’échange du CO2. Au niveau international, le marché du carbone, encore considéré à la fin des années 90 comme un simple appoint à des mesures domestiques, apparaît aujourd’hui à la plupart des décideurs comme l’unique outil de la lutte contre le réchauffement climatique.
• Les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont presque uniquement concentrées sur le gaz carbonique, et négligent gravement le méthane et le protoxyde d’azote qui ne font l’objet d’aucun plan international d’envergure. L’absence totale de référence à ces gaz, dans le Grenelle de l’environnement français, dans les délibérations des conseils des ministres de l’environnement européens ou dans le dernier rapport du PNUD sur le réchauffement climatique est très significative de cette négligence.
C’est donc dans une configuration profondément renouvelée que les questions d’énergie et de climat se posent à la veille d’un bilan final du protocole de Kyoto (qui sera effectué en 2012), qui, vu de 2008, a toutes chances de montrer que les objectifs que s’étaient fixés de nombreux pays ne seront pas respectés.
Arrêtons donc de tergiverser !
En effet, ou bien nous sommes capables collectivement d’infléchir avant 2020 les émissions mondiales de GES [2] et de les réduire d’au moins 30 % d’ici 2030, ou bien il ne nous restera plus qu’à « nous adapter » sans d’ailleurs que personne ne sache bien ce que recouvre ces deux mots, « nous » et « adaptation ».
Certains ont déjà franchi le pas : secrètement convaincus qu’il est trop tard pour prévenir la dérive climatique, ils pensent que c’est dès maintenant dans l’adaptation qu’il faut mettre toutes ses billes.
On sait, grâce aux études de Nicolas Stern, que le coût de cette adaptation, même pour une augmentation modérée, de l’ordre de 3 degrés de la température terrestre, risque d’être gigantesque. Mais, au delà, personne ne sait si cela est simplement possible. De là à considérer que la meilleure solution est de réserver cette adaptation à une élite (quelques centaines de millions d’individus), bien entendu la plus riche, il n’y pas loin ! Tant pis pour les autres si cela permet aux premiers de conserver le niveau de vie qu’ils ont aujourd’hui et d’échapper au déluge en embarquant sur ce moderne avatar d’arche de Noé ! [3].
D’autres, obnubilés qu’ils sont par la nécessité de produire et de vendre toujours plus pour satisfaire leurs actionnaires, évoquent l’émergence imminente de ruptures technologiques salvatrices pour justifier leur irresponsabilité immédiate [4].
Certains, comme tétanisés par l’ampleur de la menace, préfèrent n’y pas penser et refoulent dans leur inconscient l’orage qu’ils redoutent.
D’autres enfin, et parmi eux un certain nombre de scientifiques, parfaitement conscients de la gravité des risques, hésitent pourtant à alerter l’opinion, par peur de voir remettre en cause les quelques acquis de la négociation internationale.
Nous n’avons pourtant pas d’autre choix que de regarder la réalité en face et de réagir. Mais encore faut-il se convaincre et convaincre les autres que c’est encore possible et ne pas se tromper de remède face à ce nouveau diagnostic.
Les marges de manœuvre
Les politiques internationales proposées aujourd’hui pour lutter contre le réchauffement du climat reposent sur trois postulats :
• Puisque le CO2 apparaît comme de très loin le premier responsable du réchauffement climatique, c’est la question énergétique qui constitue l’essentiel de la problématique du climat.
• Comme il ne saurait être question de remettre en les objectifs de croissance économique, même dans les pays riches [5], et que la liaison de cette croissance avec la consommation d’énergie reste déterminante (même si on peut l’atténuer par des efforts d’économie d’énergie) la seule voie sérieuse réside dans la substitution d’énergies non carbonées aux énergies fossiles.
• Seul le marché est susceptible d’apporter l’efficacité et la flexibilité indispensables à toute action d’envergure.
Dans le contexte actuel de flambée du pétrole et de dérégulation systématique des marchés énergétiques, ces postulats rencontrent d’autant plus de succès :
• qu’ils viennent apporter les justifications qui faisaient cruellement défaut à certains lobbies énergétiques pour relancer leur activité (c’est le cas pour le nucléaire, en déclin depuis une décennie) ;
• et qu’ils permettent aux pouvoirs publics de s’exonérer à bon marché de leur responsabilité principale, celle du moyen et du long terme, en s’abritant derrière les exigences du marché et les contraintes de la mondialisation.
Effet de serre = énergies fossiles, postulat à reconsidérer d’urgence
Pourtant, puisque, comme nous venons de le voir, c’est d‘un horizon de 20 ou 30 ans qu’il faut d’urgence nous préoccuper, nous ne pouvons pas éviter de revisiter les règles d’équivalence des différents gaz à effet de serre avec le CO2 utilisées actuellement. Elles sont en effet totalement décalées par rapport à nos besoins puisqu’elles sont destinées à juger d’effets à 100 ans d’actions ponctuelles de réduction d’émission de ces gaz (2108 pour une action ponctuelle engagée en 2008), alors que nous avons besoin d’outils d’analyse de politiques pérennes à l’horizon de 20 ou 30 ans.
C’est tout particulièrement important pour le méthane (CH4) dont le « potentiel de réchauffement global » (PRG) varie très vite avec l’horizon auquel on s’intéresse [6]. De 80 à 15 ans le PRG du méthane passe à 42 à 50 ans et à 21 (la valeur retenue actuellement) à 125 ans. Sans compter que le PRG a été défini comme la réponse à une émission ponctuelle de CH4 par rapport à une émission ponctuelle de CO2. Si on s’intéresse à des politiques, pérennes de réduction de méthane, la sous-estimation de l’effet du méthane sur la période atteint un facteur 4,6 en 2020 ; 3,9 en 2030, et 2,75 en 2050 par rapport aux estimations actuelles. Ce n’est évidemment pas rien !
Et surtout, si l’on tient compte de cette réalité, cela veut dire qu’il faut remettre en cause le « tout CO2-tout énergie » des politiques actuelles de lutte contre le réchauffement climatique. Et ce, d’autant plus que des réductions importantes d’émissions de méthane, de l’ordre de 25 à 30%, sont parfaitement envisageables, à des coûts raisonnables, aussi bien dans les pays riches que dans les pays en développement à horizon de 10 ou 20 ans, sans remise en cause du développement économique de ces derniers [7].
Combinée avec un effort de réduction des émissions de N2O de 15 à 20% dans les pays développés, largement imputable à la surconsommation d’engrais azotés, l’action sur ces gaz, considérée à tort comme marginale, pourrait contribuer à hauteur de 65% environ à l’effort indispensable à l’horizon 2030 et encore de près de 60% en 2050 [8].
Engager des politiques spécifiques gaz par gaz et désacraliser le marché
On a vu plus haut que la traduction d’objectifs multigaz par un objectif en tonnes eq CO2 n’est pas neutre : si l’on réduit plus le CH4 à court terme, au détriment de l’effort sur le CO2, les conséquences se feront sentir à long terme (au-delà de 100 ou 150 ans) et si l’on réduit plus le CO2 en relâchant l’effort sur le CH4, on renforce le risque de déclenchement de phénomènes irréversibles et cumulatifs à court terme. Il faut donc s’attaquer aux deux en tenant compte de leurs spécificités.
Il est urgent de revenir à des objectifs gaz par gaz pour respecter la dynamique de réduction des émissions que nous indiquent des climatologues.
Pour ces mêmes raisons, le postulat sur lequel se fonde l’actuel marché du carbone (selon lequel il serait légitime d’établir, via la tonne equivalentCO2, des équivalences entre des actions très diverses, de durées de vie très variées et sur des gaz dont l’effet sur le climat dépend très largement du temps) conduit en fait à des distorsions importantes, voire à des absurdités [9]. Le marché, qui peut être efficace lorsqu’il vise des acteurs qui agissent dans des secteurs déterminés et sur un type de gaz donné (par exemple les électriciens pour le CO2) est très loin d’être suffisant pour répondre à l’ensemble des problèmes posés, ne serait-ce que parce que son accès est très inégalitaire [10].
Sans compter que la logique financière et spéculative qui préside à la bourse du carbone largement déconnectée des réalités de la physique n’est pas sans risque. Et puis pourquoi, par exemple, la bourse du carbone échapperait-elle , seule parmi les autres, aux phénomènes de « bulle spéculative » avec les conséquences qu’on peut en attendre sur le plan du climat. Par exemple la prise en compte par le marché des nouveaux coefficients du CH4 dont nous avons parlé, raisonnable sur le plan de la physique, comporte deux risques simultanés : celui de voir les investissements se porter uniquement sur le méthane (3 ou 4 fois plus rentable qu’initialement prévu), au grave détriment de la réduction du CO2, et celui de voir la valeur d’échange du carbone s’effondrer d’autant [11].
Il est donc urgent de réhabiliter les politiques et mesures (taxes, réglementations sectorielles, incitations diverses) qui permettent de cibler très précisément les potentiels sectoriels d’action en fonction des objectifs sur chacun des GES et de ramener les instruments de marché à un rôle plus conforme à leur réelle efficacité et mission originelle.
Résumons nous
Devant l’urgence d’un risque climatique majeur, à court terme, nous ne pouvons plus en rester aux discours sur les vertus du marché et la foi dans la science et les ruptures technologiques. Nous pouvons encore nous protéger du pire à condition de nous engager à très court terme et pour les 20 ans qui viennent :
1. Dans un effort sans précédent de maîtrise la demande l’énergie, essentiel pour assurer dans le long terme la réduction du CO2 et qui converge avec les préoccupations d’épuisement des ressources fossiles et les préoccupations économiques (en particulier la ruine des économies des pays en développement).
2. Dans un effort maximum de développement et de diversification vers les énergies renouvelables, non seulement, comme on commence à le faire, pour l’électricité, mais aussi pour les applications thermiques et carburants, en faisant la plus grande attention (au contraire de la pratique actuelle), aux questions de concurrence d’usage des sols et de bilan environnemental des filières.
3. Dans un programme mondial prioritaire et urgent de réduction des émissions de méthane partout où c’est possible qui contribuera fortement à diminuer le risque d’un pic fatal de concentration de GES à court et moyen terme, en attendant que les deux premières politiques, dont les dynamiques sont plus lentes et dépendent des rythmes de développement, atteignent la plénitude de leur effet bénéfique sur le climat.
Depuis plus de 20 ans, bien d’autres que nous ont montré la nécessité et l’urgence de s’engager sérieusement sur les deux premiers points, à la fois pour des raisons économiques et des raisons environnementales. Ils n‘ont pas été écoutés par nos gouvernants qui se sont contentés, pour la plupart, de prodiguer quelques conseils de modération aux consommateurs que nous sommes, mais se sont bien gardés d’engager des politiques sérieuses d’économie d’énergie qui auraient pu mettre en cause une croissance économique, considérée comme la seule issue possible, fondée sur le productivisme et le monopole de fait d’entreprises plus soucieuses de leur profit que de l’avenir de l’humanité et de notre planète. Ils sont donc largement responsables de la situation critique dans laquelle se trouve aujourd’hui l’humanité. Il serait insupportable qu’ils tergiversent encore au prétexte qu’il faut attendre que tous les pays du monde se mettent d’accord pour agir ou que de nouvelles technologies miracle viennent nous sauver, ou pire encore qu’il n’est plus temps d’agir mais seulement de construire, avant le déluge, l’arche de Noé de l’apartheid climatique.
Oui, nous avons les moyens réagir, mais maintenant. Dans 10 ou 20 ans, il sera trop tard.
 Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992
Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992